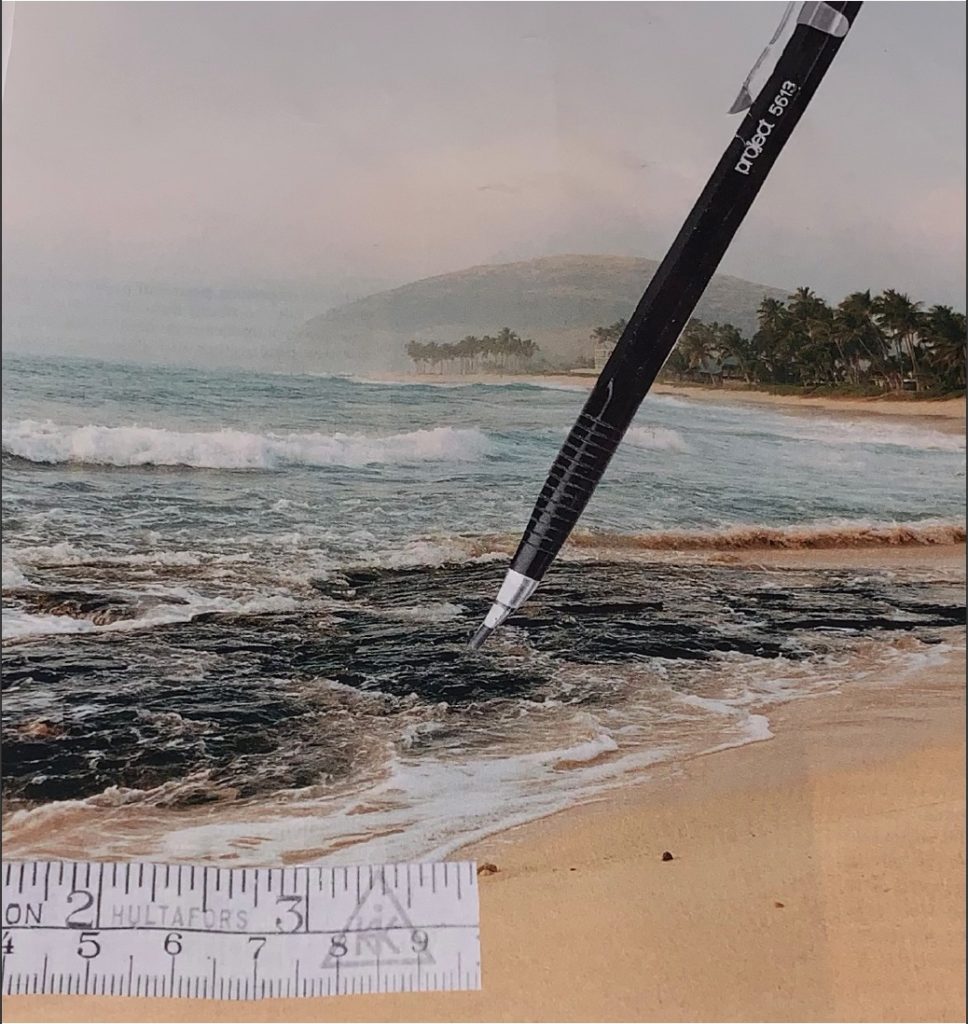Rebecca Amsellem Vous proposez dans votre ouvrage, La Philosophie du sanglot, une lecture philosophique et féministe (ou philosophico-féministe) du sanglot. Sanglots qui, pour reprendre vos propres mots, surviennent en général dans une situation d'impuissance avec un corps dont le mouvement incontrôlable redouble cette même impuissance. Vous les décrivez même comme ces « Secousses, contractions, spasmes, (qui) ils sont une attaque du corps contre la parole, la pensée, la station debout. Autant de facultés censées faire de nous des sujets ». Pourquoi avoir choisi les sanglots comme prétexte à l’étude de l’impuissance ?
Estelle Ferrarese J'inscris mes travaux dans la lignée de l'école de Francfort, et notamment la préoccupation qu'avait Theodor W. Adorno pour ce qu'il appelle la micrologie ou le regard micrologique, c'est-à-dire le fait de s'arrêter sur des phénomènes minuscules, assez banals et d'avoir une réflexion philosophique sur des choses beaucoup plus grandes à partir de ça. Par ailleurs, j’avais envie de travailler sur le corps, sa vulnérabilité mais je n'arrivais pas à l'attraper de manière un peu concrète. Je cherchais quelque chose de petit : les sanglots sont petits. Au final, le choix des sanglots s’est révélé comme une épiphanie. Je ne sais s’il est juste d’appeler ce moment ainsi : quand on réfléchit à ce qu'on veut écrire, il existe toujours ce moment où tout se met en place. C’est ce qu’il s’est passé avec les sanglots.
Rebecca Amsellem Votre analyse des sanglots est genrée, vous le dites dès l’introduction. Et vous mentionnez dans les toutes premières pages les sanglots des hommes – les sanglots d’Héraclès ou d’Achille, des héros d’Homère. Sanglots qui auraient été qualifiés de complètement efféminés par
des Elon Musk ou des Trump. D’ailleurs, vous dites, ces sanglots n’étaient pas acceptables pour Platon, qui a appelé à la censure de passages de l’Iliade et l’Odyssée et asseoir une vision plus « virile » des héros. Ainsi, lorsqu’on parle de masculinité toxique, on comprend ici qu’il s’agit d’une stratégie tout à fait consciente de la part de ceux qui ont le pouvoir (je sais que les sciences politiques ne sont pas votre domaine mais je ne peux pas m’empêcher d’y penser).
Estelle Ferrarese Il existe, en philosophie comme dans d'autres domaines, une méfiance récurrente à l'égard des débordements émotionnels, en particulier lorsqu'ils sont associés aux larmes. Cette inquiétude tient au fait que les larmes sont perçues comme féminines, soit parce qu'elles sont majoritairement versées par des femmes, soit parce qu'elles incarnent une forme d'expression jugée trop féminine. D'un côté, la société assigne aux femmes le rôle de pleurer – c'est un comportement attendu, toléré, voire encouragé. Pourtant, cette tolérance demeure strictement encadrée : il leur est permis de pleurer, mais seulement dans certaines limites et sous des formes précises. Il existe ainsi une tension constante entre l'injonction à exprimer l'émotion et la crainte du débordement.
Depuis l’Antiquité, en philosophie, dans l’Église ou à travers les préoccupations moralistes du xixᵉ siècle, on observe régulièrement des mises en garde : il ne faut pas aller trop loin, car un certain ordre est menacé. Ce contrôle des émotions ne concerne pas seulement les femmes ; il révèle aussi une peur plus large, celle d’une possible contamination des hommes par cette sensibilité excessive. C'est précisément cette inquiétude que l'on retrouve chez Platon dans le passage auquel vous faites référence.
Rebecca Amsellem Vous écrivez d’ailleurs « La permission accordée aux femmes de sangloter, voire l’incitation dont elles sont l’objet à le faire, est donc toujours conditionnelle et étroitement surveillée ».
Estelle Ferrarese Ces deux aspects sont indissociables. Il ne s'agit pas seulement d'autoriser les femmes à pleurer tout en interdisant cette expression aux petits garçons en les éduquant à réprimer leurs larmes. C’est un ensemble.
« Ce n’est pas tant une relation de causalité qu’un écho perpétuel entre l’expérience vécue et l’expression corporelle, un va-et-vient incessant où l’un et l’autre se rejoignent sans hiérarchie. »
Rebecca Amsellem Pour proposer cette lecture féministe des sanglots vous vous appuyez sur un corpus merveilleux de textes, scénario, tableau, spectacles de danse et vous vous attardez notamment sur Café Müller (1978), un ballet de Pina Bausch réunissant trois danseuses et trois danseurs qui expose la relation des corps féminins et masculins au monde, oscillant entre heurt et sanglot. La pièce, vous écrivez, « explore le désespoir et l’impuissance d’un désir constamment contrarié, se heurtant à celui de l’autre, inconstant, inconséquent, insaisissable. Ces corps féminins dansent un sanglot, traduisant un hoquet dont les vibrations parcourent chaque extrémité de leurs membres » et vous ajoutez « Le cognement dans les choses est un échec socialement déterminé de l’installation de soi au centre de l’espace ». Votre lecture du sanglot est aussi genrée, comme si les sanglots d’une femme sont précurseurs de son échec d’être sujet : l’echec représentant le moment où elle arrête d’essayer.
Estelle Ferrarese Pour penser l’impuissance, comme vous l’avez remarqué, je m’appuie sur l’idée de prise sur le monde, que j’emprunte notamment à Beauvoir. J’en arrive ainsi à une conception du heurt comme l’expérience même de l’absence de prise. Se heurter, c’est être confronté à une résistance, à un monde qui ne se laisse pas saisir. C’est précisément ce que donne à voir cette pièce : un état de collision perpétuelle. L’« étant donné », l’« étant su », ne cessent de se cogner aux chaises renversées, aux tables, aux autres corps – y compris aux hommes. Ces saccades, ces
mouvements brusques, des points de suspension, incarnent en quelque sorte l’expérience même des corps féminins dans leur rapport au monde et à autrui. Il y a une résonance entre ces gestes physiques et leur condition existentielle. Ce n’est pas tant une relation de causalité qu’un écho perpétuel entre l’expérience vécue et l’expression corporelle, un va-et-vient incessant où l’un et l’autre se rejoignent sans hiérarchie.
"Ce qui définit l’impuissance, c’est justement l’absence de prise".
Rebecca Amsellem À propos de la pièce, vous écrivez : « Les hommes tracent des lignes, ils sont maîtres de l’espace, les femmes ne dessinent que des traits brisés, des saillies et des points de suspension. » Elles ne font que s’adapter à cet espace. Vous ajoutez même qu’elles y sont captives : en témoigne leur statut de « prises » pour reprendre le langage familier. Vous citez à ce sujet Sartre dans L’Être et le Néant, Sartre « en prenant et en caressant la main de l’Autre, je découvre sous la préhension que cette main est d’abord une étendue de chair et d’os qui peut être prise ». Et « être une prise », précisez-vous en citant Iris Marion Young, est « l’objet potentiel des intentions et des manipulations d’un autre sujet ».
Estelle Ferrarese Oui, c’est exactement cela. La question est de savoir jusqu’à quel point nous pouvons réfléchir lorsque nous prêtons réellement attention. C’est pourquoi l’idée de prise sur le monde me semble essentielle : elle me permet d’explorer cette notion en profondeur, même si d’autres y trouvent un intérêt pour des raisons différentes des miennes. Ce qui m’intéresse, c’est précisément cette prise comme forme de puissance. Une puissance certes imparfaite, mais qui demeure une capacité d’agir sur le monde, de s’y ancrer, d’y exercer un certain contrôle, aussi mince soit-il. Or, ce qui définit l’impuissance, c’est justement l’absence de prise. Non seulement parce que cela traduit une forme de vulnérabilité, mais aussi parce que le monde lui-même ne nous offre pas toujours de prise. Il n’a pas été conçu pour nous. Si l’on pousse cette réflexion jusqu’au bout, il faut aussi interroger ce que signifie être une prise. Les femmes, en ce sens, sont des prises, des proies. Une fois prises, elles sont « prises » au sens propre comme au figuré. Cette idée ouvre alors une autre réflexion : être préhensible, être offert à l’appréhension des hommes, parfois même en deçà de toute intention. Le corps féminin se retrouve ainsi proposé, mis à disposition, indépendamment même de la volonté de celle qui l’habite.
Rebecca Amsellem Vous évoquez également une autre notion, celle de l’intimation à se gouverner soi-même, mise en lumière par Michel Foucault. Il me semble qu’elle s’est transformée dans notre société, que l’on peut qualifier, à bien des égards, de société de la performance. Désormais, elle s’exprime sous la forme d’une injonction à concevoir et à mener sa vie sous le prisme du choix. Les individus ne se construisent et ne demeurent sujets qu’à condition d’exercer en permanence leur liberté. Or, c’est ici que surgit un paradoxe : comment concilier l’absence de prise – être pris(e) plutôt que prendre – avec l’injonction à multiplier les choix ? On exige de chacun qu’il fasse des choix, mais pas trop. Il faut en faire suffisamment pour entretenir l’illusion d’une liberté étendue, tout en maintenant un cadre où ces choix restent contrôlés et limités.
Estelle Ferrarese C’est exactement le paradoxe auquel nous sommes confronté·es aujourd’hui. Il y a une évolution, bien sûr, et il est essentiel de réfléchir à la manière dont l’oppression du vivre varie d’une époque à l’autre. Évidemment, la situation n’est plus la même qu’à une époque où les femmes n’avaient aucun droit et étaient juridiquement minorisées. Aujourd’hui, une égalité formelle et légale leur est reconnue, ce qui implique également l’accès au statut de sujet. Or, être sujet, c’est être celui qui se détermine. Mais, comme le souligne Foucault, dans notre société contemporaine, ce statut s’est resserré autour de l’idée du choix : être sujet, ce serait avant tout faire des choix. Pourtant, se déterminer et faire des choix ne sont pas exactement la même chose. Le second est une version appauvrie du premier, plus conforme à une logique libérale : faire des choix, c’est simplement sélectionner parmi des options préexistantes, déjà définies. Cette injonction à l’autodétermination sous une forme extrêmement limitée concerne tout le monde, hommes comme femmes. Le paradoxe, et même la cruauté de la situation, réside dans le fait que tant que les femmes étaient reléguées à une domination brutale, réduites au statut d’objets, elles n’avaient pas à prouver qu’elles étaient des sujets. Elles étaient à la disposition d’autrui, et la question de leur capacité à faire des choix ne se posait même pas : ces choix étaient faits pour elles. Aujourd’hui, avec l’acquisition de cette égalité formelle, elles sont sans cesse sommées de démontrer leur statut de sujet, de façonner leur vie et leur corps selon des critères précis. Et pourtant, comme vous le soulignez, leur prise sur le monde demeure extrêmement limitée. Elles restent dans une posture de « prise », vulnérables aux forces qui les traversent et les contraignent. Elles se retrouvent alors face à une impasse : elles doivent prouver ce qu’elles ne sont pas, ce qu’elles ne peuvent pas être, compte tenu de la configuration actuelle du monde.
Rebecca Amsellem Notre société offre des espaces, depuis une trentaine d’années environ, où les blessures émotionnelles deviennent un spectacle et où le sujet se construit sur une blessure. On pense à Oprah Winfrey, ou encore Loft Story. « Le sujet naît, vous dites, et se consolide dans la mise au travail de ses sanglots, il se trouve astreint à conférer une productivité à ce moment d’improductivité radicale » : à ce sujet, vous citez les travaux d’Eva Illouz. De quelle manière (comment, quand) l’institutionnalisation d’une mise en forme des émotions est une manière de nous enjoindre à travailler activement sur sa vie émotionnelle pour se considérer sujet ?
Estelle Ferrarese Il me semble qu’il y a derrière tout cela un diagnostic à poser : celui d’une impuissance généralisée. Bien sûr, certaines formes d’impuissance sont plus marquées chez certains groupes et encore plus chez certains individus, en particulier les femmes. Mais de manière générale, la dernière chose sur laquelle nous avons peut-être encore un peu de prise, ce sont nos émotions. Et si l’on ne peut plus transformer le monde, alors il reste au moins la possibilité de se transformer soi-même.
N’est-ce pas cela, en partie, qui explique l’intérêt croissant pour les émotions et leur mise au travail ? Cette question s’articule à plusieurs dynamiques. Vous avez parlé du « comment », mais aussi du « quand ». Et je pense qu’on peut situer cette transformation à la fin des années 1990, à travers des travaux en sociologie, mais aussi dans le marketing, qui s’est intéressé à la manière dont les émotions, les sentiments moraux et les affects pouvaient être exploités dans le travail.
Le travail ne se limite plus seulement à fournir sa force physique et un certain nombre d’heures à un employeur. Désormais, il exige aussi un investissement émotionnel : il faut y croire, s’engager jusqu’à l’épuisement, rechercher sans cesse la reconnaissance, se vendre soi-même, et pas seulement sa force de travail, pour reprendre les termes de Marx. Cette évolution s’est particulièrement cristallisée dans les années 1990, notamment à travers les discours sur l’empathie dans le management : le « meilleur » manager est celui qui sait faire preuve d’empathie.
Ce changement, qui touche le capitalisme dans son ensemble, s’accompagne d’une instrumentalisation croissante de la psychologie, notamment sous la forme du coaching. Ce dernier propose des méthodes pour optimiser et rentabiliser ses émotions, les mettre au service de la performance. Si l’on devait dater cette mutation, je situerais son émergence à la fin des années 1990, dans ce que certains ont appelé le « capitalisme émotionnel » (comme Eva Illouz) une notion qui me semble ici particulièrement pertinente.
Rebecca Amsellem Vous écrivez « Embrasser son impuissance, ainsi que nous y contraignent les sanglots, ne permet aucune réussite, ne se sédimente en aucune sagesse, qu’elle soit du corps ou de l’esprit. » Les sanglots semblent donc être a priori un échec au sens que notre société voudrait l’entendre.
Estelle Ferrarese Oui, c'est exactement ça. En fait, je parle de suspension pour évoquer un moment où l'on se libère de certaines attentes. Dans le livre, vous remarquerez que je me montre assez réticente face aux lectures ultra-politiques. Cependant, je pense qu'il existe un phénomène intéressant à observer : cette suspension crée une bulle totalement improductive, une pure dépense. Et, en ce sens, c'est presque un acte de sabotage, un rejet du principe d'utilité, d'efficacité et d'accumulation qui caractérise le capitalisme et la logique du sujet qui l’accompagne.
Rebecca Amsellem Si les hommes n’ont plus le droit de sangloter, les génies se doivent en revanche d’être mélancoliques. « La mélancolie est le propre des hommes de génie, le revers cruel d’une supériorité, la sombre source de la création, son châtiment. Elle frappe, nous l’avons vu, tout singulièrement les philosophes. De quelle manière la philosophie lie-t-elle la mélancolie masculine et le génie masculin ?
Estelle Ferrarese Il y a cette idée récurrente du lien entre la mélancolie et le génie, qui a donné lieu à une multitude d’interprétations philosophiques et artistiques pendant des siècles. C’est un texte au départ attribué à Aristote qui en parle pour la première fois.Ce texte a ensuite été attribué à un « pseudo-Aristote », et aujourd'hui on pense qu’il s’agissait plutôt d’un autre philosophe, dont on n’est pas tout à fait sûr de l'identité.
Dès que cette idée de grandeur et de mélancolie apparaît, elle est immédiatement liée à la philosophie. Par la suite, de nombreuses personnalités se sont revendiquées mélancoliques dans leur approche philosophique. Ce n’est pas exclusif à un seul domaine, mais on peut citer des figures comme Kierkegaard, Sartre, avec La Nausée, l’autre nom de la mélancolie, Walter Benjamin.
La raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet, c’est que, lorsque j’ai commencé à écrire, j’ai été frappée de constater qu’il n’y avait quasiment rien sur les sanglots, ni sur le plan médical ni autre, à part une étude datant de 1907. C’est assez incroyable qu’il n’y ait pas eu davantage de recherches sur ce phénomène. C’est alors que j’ai réfléchi à l’idée que ce silence pouvait être dû au fait que les sanglots sont, en grande partie, un phénomène féminin, et donc ils ont été largement ignorés, aussi bien du côté scientifique que du côté artistique. En revanche, la mélancolie, qui est une figure largement masculine, a été abondamment commentée, écrite, peinte, jouée, etc. Ce que je voulais montrer, c’est que, si la mélancolie a été tellement mise en scène, c’était parce qu’elle était associée au génie, et elle a bénéficié d'une grande visibilité. Tandis que les sanglots, eux, ont été laissés de côté. Il y a une sorte de complémentarité entre la visibilité de l’une et le manque de visibilité de l’autre.
Rebecca Amsellem J’ai une dernière question, celle que je pose à tout le monde : c’est la question des utopies féministes. Imaginez que vous vous réveillez un matin, comme chaque jour, mais avec la sensation que quelque chose autour de vous, ou même en vous, vous fait comprendre qu’on vit enfin dans cette société féministe dont on rêve souvent. Pour vous, quel serait ce détail ? Ça pourrait être quelque chose dans votre maison, dans la rue, une pensée qui vous traverse, ou même un geste de votre famille, de vos proches. Un petit déclic qui vous dirait : "C’est bon, on y est. Je ne sais pas ce qui a changé, mais je suis dans cette société."
Estelle Ferrarese C’est le fait de ne pas avoir peur - dans l’espace public, la nuit, …