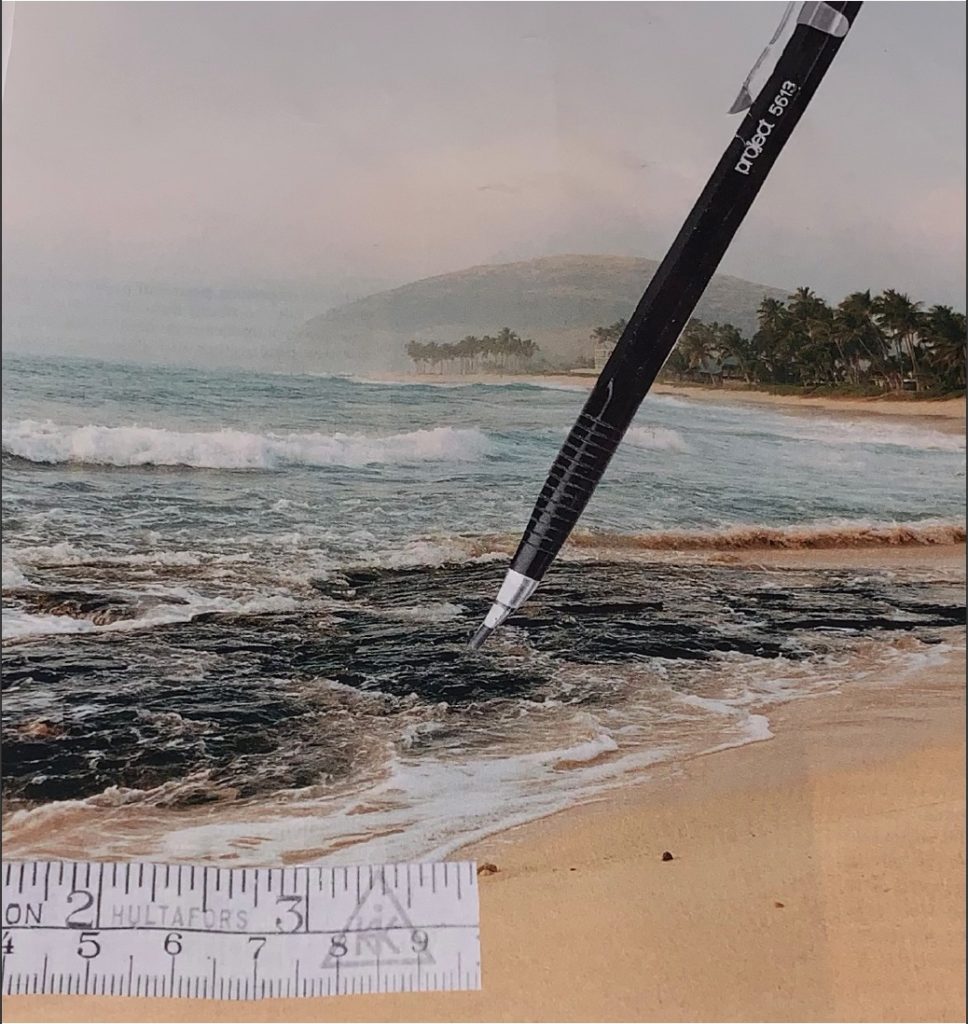Les Glorieuses
Inscrivez-vous à la newsletter. C'est gratuit et c'est tous les mercredis.
Les dernières newsletters
Impact (francais)
Vous aimez la newsletter Impact ? Pensez à faire un don ! Votre soutien nous permettra de financer cette newsletter et de lancer des nouveaux projets. ❤️ Je fais un don 100 000 personnes pour une marche des fiertés historique à Budapest par Agustina Ordoqui Bienvenue dans Le Bulletin, votre résumé mensuel de l’actualité sur les … Lire la suite
#LesPetitesGlo
Petits mots aux Petites Glo
<!– Je suis convaincue que la plupart d’entre nous ne grandissent pas. On apprend à se garer, à rembourser ses cartes de crédit, on se marie, on ose avoir des enfants et on appelle cela grandir. Or, nous nous contentons de vieillir. Nous accumulons les années dans notre corps, sur notre visage, mais, au … Lire la suite
La Preuve
Les hommes ont une plus grosse empreinte carbone que les femmes
Bienvenue dans La Preuve, le supplément de la newsletter Impact créée pour mieux comprendre les inégalités de genre — et comment on pourrait les résoudre grâce aux sciences sociales. Les hommes ont une plus grosse empreinte carbone que les femmes par Josephine Lethbridge Vous pouvez lire la newsletter en ligne ici – https://lesglorieuses.fr/hommes-empreinte-carbone/ La viande … Lire la suite
Les Glorieuses
Recommandations de juin
Lire la newsletter en ligne Des choses que je recommande par Rebecca Amsellem (pour me suivre sur Linkedin c’est ici et Instagram c’est là) 1. Un bulletin météo (c) mytherapistsays 2. Une vérité 3. Un podcast Il y a 20 ans, Gregor a prêté quelques CD à un ami musicien, Moby. Ces CD ont contribué à créer les plus grands … Lire la suite
Impact (francais)
“Nous sommes des footballeuses, nous sommes des femmes”
Bienvenue dans la newsletter Impact – votre guide de la révolution féministe. Cette semaine, nous donnons la parole à des femmes trans qui ont perdu le droit de jouer au football en Angleterre. Pressé·es ? Voici la newsletter en bref: ⚽ Les fédérations anglaise et écossaise de football ont interdit aux femmes trans de jouer, … Lire la suite
Les Glorieuses
Sandra Laugier
*** Si vous souhaitez nous soutenir et faire un don, c’est ici *** Dire la vérité, c’est se risquer. Entretien avec la philosophe Sandra Laugier par Rebecca Amsellem (pour me suivre sur Linkedin c’est ici et Instagram c’est là) https://lesglorieuses.fr/sandra-laugier/ Sandra Laugier est professeure de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de France. … Lire la suite
Nos campagnes politiques
Défendre ses droits et s’engager.
Parce que le personnel est politique, Les Glorieuses s’engagent depuis 2015 dans plusieurs campagnes qui visent à lutter contre les inégalités de genre.
Vous allez adorer consulter votre boîte mail.
Les Glorieuses, c'est bien plus qu'une newsletter. Notre mission :
créer une communauté qui vous donne le sentiment que
vous pouvez tout faire. Découvrez l'aventure et
rejoignez les 150.000 femmes (et
quelques hommes) qui en
ont marre du
patriarcat.
Les Glorieuses, c'est bien plus qu'une newsletter. Notre mission :
créer une communauté qui vous donne le sentiment que
vous pouvez tout faire. Découvrez l'aventure et
rejoignez les 150.000 femmes (et
quelques hommes) qui en
ont marre du
patriarcat.