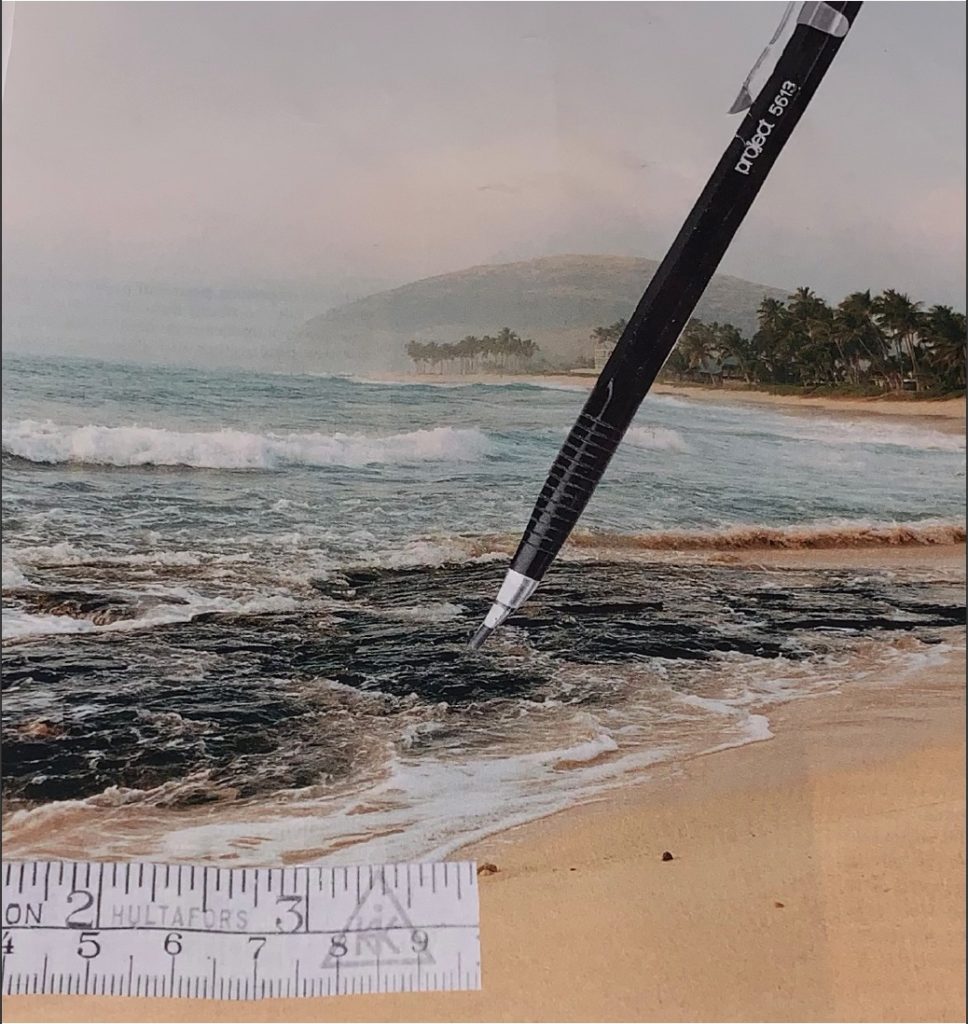|
« Je le vois dans la photo d’Erica: l’inscription d'une tragédie latente, toujours, dans chaque photo elle est là, dans le ciel au-dessus des femmes, la mer. » C’est ainsi que Marguerite Duras décrit l’œuvre de la photographe Erica Lennard ( postface de Les femmes, les soeurs, Edition des Femmes Paris 1976).
Photographe américaine, Erica Lennard construit depuis plus de cinq décennies une œuvre intime profondément habitée par les liens entre femmes.
Cet été, à l’occasion des Rencontres d’Arles 2025, son travail est mis à l’honneur dans une exposition remarquable intitulée Les femmes, les sœurs, présentée jusqu’au 25 octobre à l’Espace Van Gogh à Arles. Pensée par la commissaire Clara Bouveresse, l’exposition propose un dialogue entre les photographies d’Erica Lennard et les textes de sa sœur Elizabeth. Elle est accompagnée d’un catalogue, Erica Lennard. Avec toi et seule (Actes Sud, juin 2025).
Aujourd’hui, je vous propose donc une conversation avec Erica Lennard, nous revenons sur ses débuts à San Francisco, sa relation avec Marguerite Duras, sa vision du désir féminin, et cette question : que signifie photographier depuis la confiance ?
Cette newsletter a été réalisée dans le cadre d'un partenariat éditorial avec les Rencontres de la photographie d'Arles.

Erica Lennard. Elizabeth, Californie, printemps 1970. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / La Galerie Rouge.
Rebecca Amsellem « Elizabeth et moi sommes sœurs. Nous sommes toutes sœurs. » Ce sont les premiers mots de Les femmes, les sœurs. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet ? Qu’est-ce qui vous a poussée à créer ce dialogue entre vos images et les mots d’Elizabeth ?
Erica Lennard Le début de ce projet remonte à mes 19 ans, lorsque j’ai commencé la photographie à San Francisco. Je photographiais alors mes amies et ma sœur. Nous organisions des mises en scène inspirées de contes, avec des costumes… Mais au-delà de ces premières expérimentations, j’ai toujours porté en moi un rêve un peu plus ancien : celui de vivre à Paris. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j’avais lu les livres d’Anaïs Nin et d’autres récits qui faisaient de Paris un lieu de création, de désir, d’étude et de liberté. Je rêvais d’y avoir un salon, d’y faire des portraits de gens que j’admirais. Avec ma sœur, nous avions ce projet commun de déménager à Paris. Nous y avons vécu ensemble, et cela m’a paru tout à fait naturel de travailler avec elle : elle était comme un miroir de moi-même. Elle aussi était photographe, artiste, écrivaine… À ce moment-là, j’ai obtenu une bourse du National Endowment for the Arts. Ce n’était pas une somme considérable, mais elle a suffi à me permettre de m’installer à Paris et de commencer à travailler. Nous avions même monté un petit laboratoire dans notre salle de bains, où nous faisions nos tirages à la main.
Rebecca Amsellem Le projet Les femmes, les sœurs est né d’une relation intime, presque fusionnelle, entre vous, votre sœur et vos amies. Comment cette complicité influence-t-elle votre manière de photographier ? Comment crée-t-on des images à partir de la confiance, et non de la mise en scène ?
Erica Lennard Pour moi, la photographie vient d’abord de la tradition classique — celle d’Henri Cartier-Bresson notamment — et de cette idée fondatrice : saisir l’instant. Ce sont les instants qui m’importent. Je suis très touchée par la lumière, c’est elle qui, d’une certaine manière, fait émerger l’âme du sujet. Évidemment, la confiance joue un rôle central dans mes images. Avec ma sœur, cette confiance était là. Avec mes amis aussi. Et parfois, cette relation s’est construite autour même de la photographie : certaines personnes que j’ai photographiées sont devenues mes amies parce qu’elles avaient vu mon travail. On s’est rencontrées comme ça. Photographier quelqu’un que je ne connais pas — dans le cadre d’une commande, par exemple — représente un tout autre exercice. Il s’agit alors de parvenir à établir, très vite, le même genre de connexion, d’arriver un peu à pénétrer leur âme.
Rebecca Amsellem À une époque où le nu féminin était omniprésent, vous avez choisi de représenter des femmes « dénudées mais pas forcément nues », en subvertissant les codes de la séduction. Que vouliez-vous montrer — ou plutôt déjouer — avec cette approche ?
Erica Lennard Je pense que mon rapport au corps et à la nudité vient en grande partie de l’environnement dans lequel j’ai grandi. J’ai
grandi à Berkeley, dans les années 1960 et au début des années 1970 — une époque marquée par les mouvements de libération, notamment celui des femmes, mais aussi par une libération plus large, des esprits comme des corps. C’était un moment où la nudité n’avait rien de provocant ou de transgressif. Elle était tout simplement naturelle. Il y avait des événements où les gens étaient nus, des concerts, des rassemblements… C’était l’époque de Woodstock, des communautés alternatives. On ne parlait pas de découverte du corps ou de mise en scène : on vivait dans cette liberté, dans cette confiance collective. Personne ne regardait l’autre avec jugement ou voyeurisme. Cette atmosphère m’a profondément marquée, et elle a façonné ma vision. Je me souviens encore d’un moment très révélateur à l’école des Beaux-Arts. Il y avait un cours de nu — non pas où l’on dessinait un modèle nu, mais où le professeur et tous les élèves étaient eux-mêmes nus. Ce serait inimaginable aujourd’hui, mais à l’époque, cela ne paraissait pas étrange. C’était une autre époque, un autre rapport au corps.
Rebecca Amsellem Vous avez étudié à San Francisco, vécu à Paris, fréquenté Arles, croisé des figures comme Ralph Gibson, Agathe Gaillard, Marguerite Duras… Comment ces contextes et ces rencontres ont-ils nourri votre œuvre photographique, notamment votre rencontre avec Duras ?
Erica Lennard L’histoire avec Marguerite Duras est née un peu par hasard — comme beaucoup de choses dans ma vie, et dans la vie d’une photographe. À l’époque, je n’étais pas encore photographe. Avec ma sœur, avant d’intégrer une école des beaux-arts, nous avions décidé de passer un an en Europe. C’était en 1970, je crois. Nous voyagions un peu partout, et à un moment, nous étions à Londres. Londres, à cette époque, c’était une ville en ébullition. Il y avait des concerts partout, une énergie incroyable. Un soir, en sortant d’un concert — je crois que c’était Pink Floyd, mais je ne suis plus sûre —, nous avons rencontré deux garçons français. L’un d’eux portait un bonnet étrange, il avait un cheval… ou en tout cas, c’est le souvenir que j’en garde ! On est vite devenus très amis. L’un d’eux était le fils de Marguerite Duras. Il nous a dit : « Si vous passez par Paris, vous pouvez rester chez ma mère. » Il m’a donné son nom, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas son œuvre. Ce n’est que plus tard, en découvrant ses écrits, que j’ai réalisé qui elle était.
L’année suivante, nous sommes passées à Paris et avons effectivement logé chez elle. Très vite, une relation s’est nouée. Nous étions proches de son fils, et je pense qu’elle projetait des choses sur moi, sur nous. Elle avait ce regard très perçant. Elle voyait des âmes, elle percevait les failles, les zones d’ombre. C’est comme ça qu’elle fonctionnait. Elle aimait les êtres qui portaient en eux quelque chose de tragique ou d’intense. Nous avons ensuite passé beaucoup de temps avec elle, à Paris, à Trouville, à Neauphle-le-Château. Elle a aussi rencontré mes parents, elle a connu notre vie en Californie. Et plus tard, c’est en partie grâce à elle — ou plutôt grâce à l’expérience de sa maison et de ce qu’elle représentait pour elle — que m’est venue l’idée du livre Maison d’écrivains.

Erica Lennard. Elizabeth, Neauphle-le-Château, automne 1972. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / La Galerie Rouge.
Rebecca Amsellem La postface de Les femmes, les sœurs a été écrite par Marguerite Duras, qui parle d’une « entente vertigineuse dans sa disparité même ». De quelle manière a-t-elle influencé votre travail ?
Erica Lennard Honnêtement, je ne pense pas qu’elle ait influencé mon travail. On avait cette relation très personnelle : elle a influencé ma vie, mais pas mon travail.
Rebecca Amsellem Dans vos images, le désir féminin est présent, palpable, mais son objet reste hors champ. Était-ce un choix politique, esthétique, ou les deux ? Quelle place donnez-vous au
désir dans votre œuvre ?
Erica Lennard Pour moi, il s’agissait d’un désir de liberté, de pouvoir exister pleinement. Dans ma formation, quand j’étais jeune, on m’a souvent dit qu’une femme pouvait exister sans forcément se définir par son statut marital ou maternel. Je ne pensais pas me marier, ni avoir d’enfants. C’était une position presque idéologique, un refus de penser que la maternité était une condition nécessaire à l’existence. Je trouvais qu’on n’avait pas besoin d’avoir des enfants pour se sentir exister, pour affirmer son être. Aujourd’hui, même si je n’ai pas eu d’enfants, je comprends pleinement le lien, le désir profond que certaines femmes peuvent avoir d’en avoir. Et c’est formidable. Ce désir est légitime et puissant. Mais je reste convaincue qu’une femme peut être entière, complète, pleinement elle-même, sans que la maternité soit une raison d’être indispensable. C’est ça, à mon sens, la liberté d’être femme.
Rebecca Amsellem Le mot sororité était presque absent du langage visuel et artistique en 1976. Aujourd’hui, il est revendiqué par une nouvelle génération féministe. Que pensez-vous de ce regain d’intérêt pour les liens entre femmes ? Avez-vous le sentiment que votre œuvre résonne différemment aujourd’hui ?
Erica Lennard Ce que je trouve absolument formidable aujourd’hui, c’est que cette exposition existe, qu’elle soit revue par une nouvelle génération, et que le livre ait été réédité. C’est quelque chose d’inespéré, vraiment. Car même s’il y a toujours eu beaucoup de discussions autour de ces sujets, je m’interroge tout de même : comment se fait-il que, cinquante ans plus tard, nous revenions sur des questions que l’on pensait avoir déjà tenté de régler à l’époque ? Ce retour pose pour moi, qui suis d’une autre génération, des questions complexes. Aujourd’hui, les débats sont traversés par de nouvelles notions, de nouvelles terminologies autour de l’identité, et je m’y perds parfois.
Rebecca Amsellem J’ai une dernière question, celle que je pose à tout le monde : c’est la question des utopies féministes. Imaginez que vous vous réveillez un matin, comme chaque jour, mais avec la sensation que quelque chose autour de vous, ou même en vous, vous fait comprendre qu’on vit enfin dans cette société féministe dont on rêve souvent. Pour vous, quel serait ce détail ? Ça pourrait être quelque chose dans votre maison, dans la rue, une pensée qui vous traverse, ou même un geste de votre famille, de vos proches. Un petit déclic qui vous dirait : « C’est bon, on y est. Je ne sais pas ce qui a changé, mais je suis dans cette société. »
Erica Lennard Ce qui me donne de l’espoir, ce que j’aimerais voir continuer, c’est par exemple ce que je vois parfois sur une plage, à côté de Marseille, là où allait mon mari quand il était petit. On y va encore. Et là, je vois un mélange incroyable de jeunes gens. De toutes sortes. Des corps parfaits, des corps très grands, de toutes les couleurs, des styles différents, des gens qui ne semblent pas avoir peur de se montrer, d’exister pleinement. Et tout ce monde-là est ensemble. Je me suis dit : si le monde pouvait ressembler à cette plage, ce serait vraiment quelque chose.
Vous aimez ce qu’on fait ? Aidez-nous à le faire encore mieux.
Un don pour vous, un grand geste pour nous : il permet à notre équipe de continuer à vous écrire chaque semaine.
Si vous souhaitez nous soutenir et faire un don, c’est ici.
Merci pour votre confiance 🫶
|